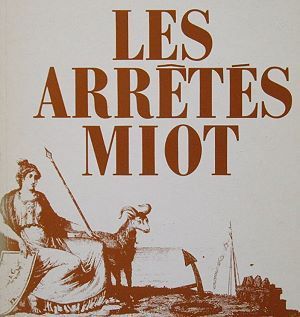Paru dans le Journal de la Corse du 21 septembre 2001
| La querelle sur l’orthographe qui a fait rage ces derniers mois, en particulier lors de la parution du livre de Pascal Marchetti L’Usu Corsu, semble s’être provisoirement calmée. Mais est-ce un signe de bonne santé pour la Corse, sa langue et sa culture ou simplement l’indice que le système a absorbé la protestation ?
Détail nous dira-t-on. Personnellement je ne suis pas de cet avis. C’est qu’au-delà des apparences le problème est grave et il implique une prise de position plus générale sur le problème linguistique et culturel. En effet, les quelques retouches proposées sont dictées par des considérations pratiques mais aussi par le sentiment, que nous sommes un certain nombre à partager, de la nécessité de maintenir ouverte, et même de favoriser la communication entre le corse et l’ita Mais tout ceci n’est qu’une conséquence de la perte de tout repère par la suite de deux phénomènes : on ne parle presque plus corse dans la vie courante et on a perdu la référence à l’italien. La première affirmation peut sembler provocatrice, elle me paraît correspondre à une réalité indiscutable. Il ne suffit pas de quelques « avancées » légales, de quelques réunions où des amoureux de la langue échangent en vase clos quelques propos choisis, de quelques publications circulant en circuit restreint, pour refuser de voir que dans l’usage quotidien et spontané notre langue recule et même est tout simplement en train de disparaître. Si le milieu corsophone disparaît, ce ne sont pas quelques stages linguistiques à la sortie desquels les participants retrouveront un milieu francophone qui inverseront la tendance. Alors que vient faire l’italien là-dedans ? Eh bien, tout d’abord il importe de réaffirmer avec force et de reconnaître officiellement qu’il a été pendant des siècles, non pas une langue étrangère imposée aux Corses, mais sous tous les régimes, y compris celui de la Corse indépendante de Paoli et durant le royaume anglo-corse, et même le régime français à ses débuts, la langue des Corses. Ce n’est pas le lieu ici de revenir longuement sur ce sujet : c’est ce qui ressort à l’évidence de l’histoire et des textes. Personne ne peut sérieusement nier le rôle privilégié de l’italien en Corse dans le passé. Il doit aussi en avoir un dans l’avenir. On peut se demander pourquoi tant de gens, souvent de bonne volonté, refusent l’évidence. J’y vois plusieurs motifs. Tout d’abord, chez un certain nombre d’entre eux, surtout les plus jeunes, une ignorance entretenue de ce que sont réellement la culture et l’histoire italiennes dans leur complexité et les différences fondamentales qui les séparent de l’histoire de la langue et de la culture françaises. Un des problèmes de la Corse est là : ses fils ont intégré en ces matières un modèle, le modèle français, qui ne rend pas compte de leur nature et ne lui laisse aucune place. D’où cette identification langue-nation, langue parlée-langue normée qui rendent incompréhensibles l’histoire culturelle et linguistique de la Corse et celle de la péninsule voisine. Ajoutons-y un enseignement identique que l’on habite Lille ou Perpignan, Bordeaux ou Bastia, exclusivement centré sur la nation française dont le concept est implicitement présenté comme le seul modèle possible, le seul démocratique, le seul légitime. Et c’est ainsi que l’on parvient au second motif d’incompréhension, l’aspect politique. On entend dire communément que le français est la langue de la liberté, de la république, de la démocratie. A l’opposé l’italien serait donc la langue de la réaction et, même si on ne l’affirme pas explicitement, du fascisme. Etrange affirmation qui, tout d’abord, néglige le fait qu’actuellement l’axe de la culture italienne est situé bien plus à gauche que celui de la culture française. Mais surtout il est incroyable que l’on puisse identifier une langue à une tendance politique, surtout lorsque cette affirmation vient de gens qui n’ont de cesse d’affirmer des positions volontaristes en matière de nationalité et de prétendre que dans ce domaine l’individu reste toujours libre et que tout est remis en jeu à chaque génération. Et puis enfin, on nous déclare que le français est la langue de la République (« la », comme s’il en était une seule), identifiant la France et la République (il ne semble venir à l’esprit de personne que faire de l’adhésion à une doctrine politique la condition de la citoyenneté est très exactement une attitude totalitaire) d’où il s’ensuit que quiconque ne parle pas français n’est pas républicain, ce qui est aimable pour les quelques milliards d’étrangers non francophones qui nous entourent. En réalité il semble évident que ce n’est là qu’un voile derrière lequel se cache le vieux chauvinisme linguistique français qui tente de faire taire ses adversaires en les discréditant. Des contacts que l’on peut avoir avec les Suisses, qui ont une tradition républicaine bien plus ancienne que les Français, il ressort qu’ils n’arrivent tout simplement pas à comprendre cette obsession uniformisante. D’ailleurs, si la république est le régime de la tolérance, ce qui en ce qui concerne la république jacobine française est à démontrer, elle devrait précisément être celui du pluralisme linguistique et du respect de toutes les cultures. L’universalisme républicain tant vanté ne sera véritablement universel que s’il s’exprime en allemand en Allemagne, en russe en Russie, en espagnol dans les pays hispanophones etc. Sinon il sera ressenti comme le masque d’un impérialisme culturel (et pas uniquement culturel) français. Il est donc inouï que les Corses, qui ont su réagir contre ce dogme lorsqu’ils s’agissait du corse, retombent dans l’ornière lorsqu’il s’agit de l’italien. La politique actuelle empêche donc d’appuyer le corse sur l’italien et de se servir de la proximité du monde italophone et des immenses potentialités qu’il offre. Affirmer, cultiver la complémentarité du corse et de l’italien créerait les conditions permettant de briser le monopole du français. Sinon on aboutit à une situation absurde comme celle que j’ai personnellement vécue chez un commerçant corse : la femme d’un touriste italien demande à son mari qui parle français (remarquons qu’elle n’a pas été incitée par l’attitude générale des Corses à tenter sa chance en italien ; alors qu’il y a quelques dizaines d’années elle l’aurait fait spontanément) de s’enquérir du prix : « quant’è ? » dit-elle, le mari s’adresse au commerçant corse : « combien ? », le Corse à sa femme « quantu face ? » (gallicisme), la femme corse à son mari : « cinquanta », le Corse à l’Italien : « cinquante », l’Italien à sa femme : « cinquanta ». Et voilà comment une situation de parole conduisant à communiquer directement sans l’aide du français a été gâchée par la faute de l’hétérogénéité officielle du corse et de l’italien. On pourrait multiplier les exemples de ce genre : à quelques exceptions près l’immense apport que pourraient constituer les touristes italiens est totalement négligé, alors que l’on devrait s’efforcer au contraire de promouvoir toute une série d’initiatives consistant à créer des occasions de se rencontrer et d’avoir des activités communes. Et il n’y a pas que le tourisme, il y a l’économie plus en général, la culture etc. Mais cela ne sera possible que si la complémentarité des deux langues est proclamée et cultivée. Tout ceci se rattache au problème de l’usage du corse dans les domaines dont il a été traditionnellement exclu. Il est tout bonnement absurde de s’imaginer que par l’intermédiaire de commissions on va créer tout un vocabulaire technique qui nous manque. Ces commissions s’essouffleront vite à suivre les créations incessantes imposées par l’actualité, d’autant plus que les occasions d’utiliser ces mots en corse ne seront pas légion. Ainsi, loin d’émanciper le corse, d’en faire une langue moderne, on le réduira à un rôle secondaire. Utilisera-t-on les mots français, ou anglais ? On aboutira rapidement à un pidgin innommable que personne ne parlera. Ce n’est que si le niveau linguistique supérieur est occupé, dans certains domaines, par l’italien que la phrase corse pourra parcourir sans effort tous les niveaux d’expression et que le corse se trouvera lui-même ennobli aux yeux de ses locuteurs. Quelqu’un qui connaît l’italien, langue dans laquelle sont traduits tous les chefs-d’œuvre de la littérature universelle et langue d’un pays moderne, trouvera exprimés dans une langue presque identique à celle qu’il a l’habitude de parler les concepts les plus abstraits et les expressions techniques les plus modernes. Si l’on a lu Platon en italien, ou si l’on connaît le vocabulaire italien des mathématiques on peut aborder ces sujets dans une phrase corse. Avec le français ou l’anglais (et même avec l’espagnol) c’est impossible, sauf à sabiriser, ce qui est évident dans les écrits de certains des auteurs corses actuels. Enfin, un autre argument avancé est celui selon lequel eu égard aux importants résultats obtenus et étant donné l’accord désormais général sur l’orthographe actuelle il ne faut surtout rien changer. Ce à quoi il est facile de répondre que de ces affirmations la première ne correspond à rien de mesurable, puisque, nous l’avons vu, le déclin du corse n’a pas été enrayé et que ce que l’on nous fait passer pour du corse devient de plus en plus un jargon incompréhensible, quant à la seconde, il importe de faire remarquer que, s’agissant de l’orthographe, les modifications proposées ne sont pas telles qu’elles constituent un bouleversement. Mais il est vrai que c’est toute la politique culturelle qui est à repenser. Il doit être évident à tous que la sauvegarde d’une identité corse ne s’obtiendra pas par des demi-mesures. Il faut avoir le courage d’effectuer des révisions déchirantes dans le domaine culturel et économique (et sans doute aussi politique). Quant à la fameuse langue polynomique telle qu’elle est actuellement conçue chez nous, sa définition demeure valable tant que l’on reste dans le domaine de la langue parlée, ou bien, à l’écrit, dans le domaine de la prose narrative et de la poésie. Dès que l’on passe aux niveaux de la langue économique, politique, technique, judiciaire, philosophique etc ., la nécessité se fait sentir d’une référence à une grande langue normée. Pour nous, pour des raisons linguistiques et historiques, cette langue ne saurait être que l’italien. Mais cela ne pourra se faire que si la structure en place accepte le dialogue. Pour l’instant elle oppose une force d’inertie qui absorbe toutes les critiques. En Corse il est bien évident que la tactique du gendarme a montré ses limites. La tactique de l’édredon semble vouée à un meilleur succès.
|
|
Paul Colombani
21/02/2002 |